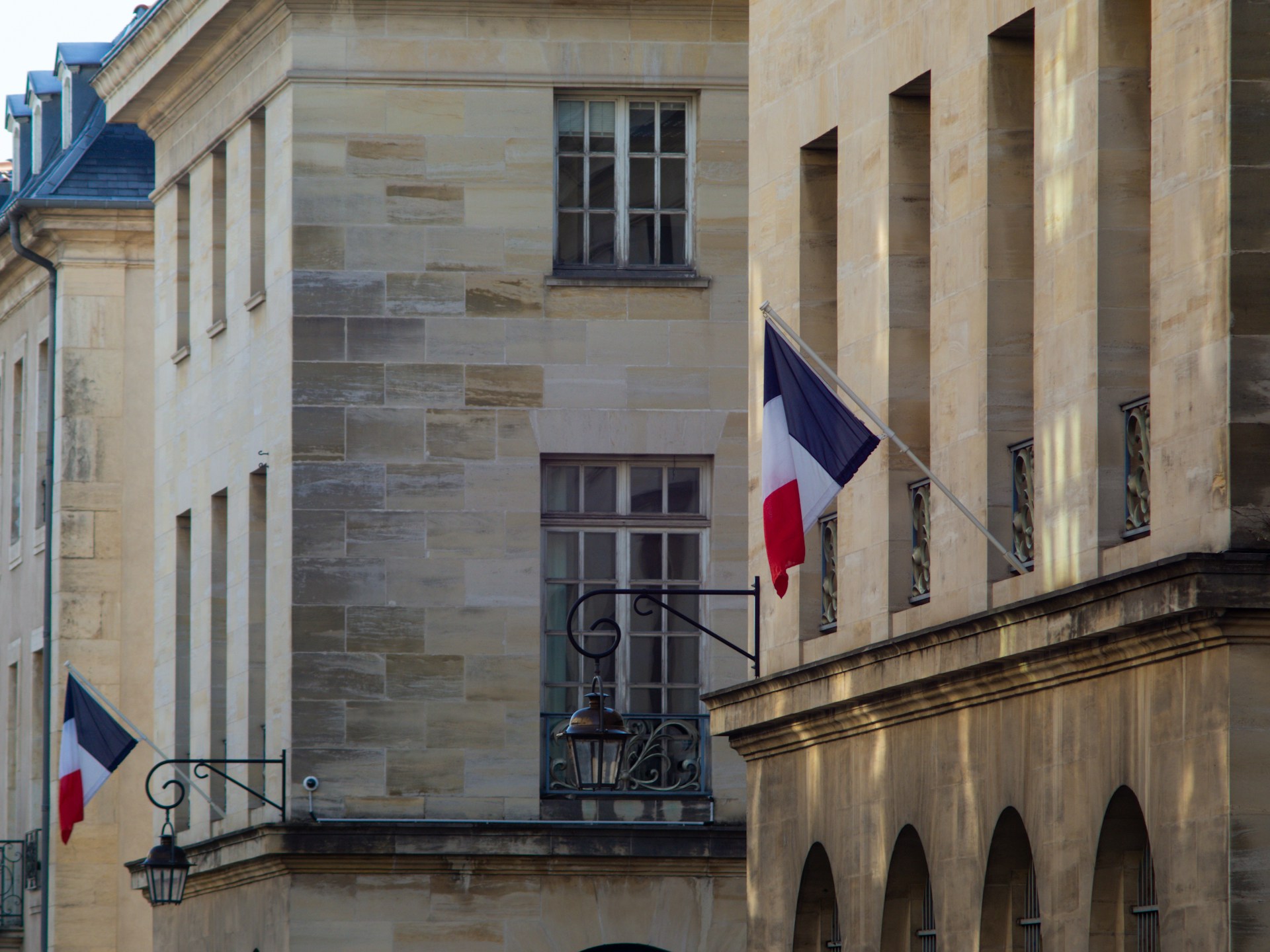
Élections municipales 2026: réponses aux questions juridiques les plus courantes des candidats
Les élections municipales de 2026 approchant, nous avons compilé une liste des questions – et les réponses associées – que se posent régulièrement les candidats aux élections locales.
Avant la campagne
Qui peut légalement faire partie d’une équipe de campagne ?
Toute personne physique majeure (ou mineure émancipée) peut rejoindre une équipe de campagne municipale à titre bénévole, sans condition particulière de nationalité ou de résidence. En revanche, certaines catégories de personnes sont soumises à des obligations particulières. Ainsi, les agents publics, notamment les fonctionnaires ou contractuels municipaux, sont tenus à une stricte obligation de neutralité. Ils ne peuvent donc contribuer à une campagne qu’en dehors de leurs heures de service, sans utiliser de moyens matériels ou humains relevant de la collectivité territoriale.
Il est fortement recommandé d’éviter toute situation de conflit d’intérêts, par exemple en refusant un directeur général des services municipaux de l’équipe de campagne du maire sortant. Pour sécuriser le fonctionnement de l’équipe, il peut être utile de mettre en place une charte d’engagement, rappelant notamment l’interdiction d’utiliser des ressources publiques (en argent mais surtout en temps d’agent public).
Des bénévoles non inscrits comme électeurs dans la commune peuvent-ils participer à la campagne ?
Oui. Aucune disposition du code électoral n’interdit de faire appel à des soutiens extérieurs à la commune. Des militants d’un parti, des proches ou des sympathisants peuvent ainsi apporter leur aide pour distribuer des tracts, animer des réunions publiques ou contribuer à la communication.
Il est essentiel de veiller à ce que leur action demeure bénévole, sauf recours à des prestataires déclarés et rémunérés par le mandataire financier.
Enfin, les bénévoles extérieurs doivent être informés des règles locales en matière d’occupation du domaine public (marchés, distribution sur la voie publique), qui peuvent nécessiter une autorisation municipale.
Comment choisir un mandataire financier ?
Le mandataire financier est une obligation légale dès lors qu’un candidat engage des dépenses ou perçoit des dons. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une association de financement électoral.
Le mandataire est seul habilité à ouvrir le compte bancaire de campagne, à percevoir les recettes (apports personnels, dons de personnes physiques) et à régler les dépenses.
Le choix doit se porter sur une personne de confiance, disponible et rigoureuse, capable de tenir une comptabilité, de conserver les justificatifs et de présenter un compte de campagne conforme.
En cas d’erreurs ou d’irrégularités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut rejeter le compte, entraînant des sanctions, notamment l’inéligibilité du candidat et l’obligation de rembourser des dépenses.
À quel moment faut-il déclarer le mandataire financier ?
La désignation du mandataire doit intervenir avant toute opération financière : impression de tracts, réservation de salle, collecte de dons ou même avance de frais par le candidat.
La déclaration s’effectue auprès de la préfecture ou sous-préfecture compétente à l’aide d’un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives (pièce d’identité, éventuellement statuts pour une association).
Une fois la déclaration enregistrée, un récépissé est délivré : ce document est indispensable pour ouvrir le compte bancaire dédié.
Toute recette ou dépense engagée avant la désignation du mandataire ne pourra pas être prise en charge par le compte de campagne et pourra être considérée comme irrégulière.
Quels sont les délais pour déposer une liste de candidats ?
Les délais sont fixés par le code électoral et précisés par l’arrêté préfectoral organisant l’élection. Pour les municipales, la déclaration de candidature doit être déposée entre la sixième et la quatrième semaine précédant le premier tour.
Le non-respect de ce délai entraîne le refus d’enregistrement. Après la clôture des dépôts, aucune modification de liste n’est possible sauf exceptions très limitées (ex. décès d’un candidat).
La déclaration doit comprendre la liste complète des candidats, les déclarations individuelles, les justificatifs d’éligibilité (pièce d’identité, inscription sur les listes électorales) et, le cas échéant, la déclaration de parité pour les communes concernées.
Qui contrôle la conformité de la liste, notamment au regard de la parité ?
Le contrôle est assuré par les services de la préfecture ou de la sous-préfecture lors de l’enregistrement de la liste.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la loi impose la parité stricte : alternance homme/femme sur toute la liste (« zébrage »), sous peine de refus d’enregistrement.
En cas de non-conformité (nombre déséquilibré ou ordre non alterné), la liste est déclarée irrecevable et doit être régularisée dans les délais impartis.
Il est donc fortement conseillé de vérifier la composition bien avant le dépôt pour éviter un refus de dernière minute.
Peut-on remplacer un colistier avant le premier tour ?
Un candidat peut être remplacé librement jusqu’au dépôt définitif de la liste en préfecture. Après l’enregistrement officiel, la liste est figée : aucun retrait ni ajout n’est autorisé, sauf cas exceptionnel de décès ou de constat d’inéligibilité prononcé par l’administration ou un juge.
En cas de retrait d’un colistier après validation de la liste, la liste reste inscrite telle quelle : si la liste obtient des sièges, le siège du colistier défaillant restera vacant.
Il est donc essentiel de s’assurer, avant le dépôt, que chaque colistier est volontaire, éligible et informé de ses engagements.
Est-il possible de recruter un directeur de campagne rémunéré ?
Oui. Le code électoral n’interdit pas de rémunérer un directeur de campagne. Cette rémunération constitue une dépense électorale : elle doit être réglée exclusivement par le mandataire financier, par virement depuis le compte bancaire dédié.
Le contrat de travail, les fiches de paie et le paiement des charges sociales doivent être conformes au droit du travail.
Cette dépense entre dans le calcul du plafond de dépenses fixé pour la campagne. Un candidat doit donc veiller à la budgétiser dès l’organisation de son financement.
Est-il autorisé de louer un local pour installer une permanence électorale ?
Oui, il est parfaitement légal de disposer d’un local dédié à la campagne.
Le bail doit être signé au nom du mandataire financier ou de l’association de financement, et le loyer doit être réglé exclusivement par le compte bancaire de campagne.
Il est interdit d’utiliser un local municipal mis gratuitement à disposition (ce qui serait assimilé à un don d’une personne morale publique, formellement interdit).
Le local doit être clairement distinct des bureaux de la mairie afin d’éviter toute confusion et toute contestation ultérieure.
Qui peut payer les frais liés à la permanence électorale ?
Tous les frais de la permanence électorale (loyer, charges, fournitures) doivent être réglés exclusivement par le mandataire financier via le compte bancaire dédié à la campagne.
Ni le candidat lui-même, ni un parti, ni une entreprise ne peut avancer ou régler ces frais en dehors du circuit légal.
En cas de non-respect, ces paiements peuvent être considérés comme des dons interdits ou comme des dépenses occultes, ce qui peut entraîner un rejet du compte de campagne par la CNCCFP et des sanctions (inéligibilité, perte du remboursement public).
Constitution de la liste
Quels critères vérifier pour s’assurer qu’un candidat est éligible ?
Pour être éligible aux élections municipales, un candidat doit :
- Être inscrit sur une liste électorale dans la commune ou y payer des impôts locaux depuis au moins 2 ans ;
- Être majeur ;
- Ne pas être frappé d’inéligibilité (ex. condamnation entraînant l’interdiction des droits civiques) ;
- Ne pas être dans une situation d’incompatibilité (ex. fonctionnaire municipal ou préfet en poste dans la commune).
Il est possible de demander à chaque colistier une copie de sa pièce d’identité, une attestation d’inscription sur la liste électorale et une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’existe aucun motif d’inéligibilité.
Un contrôle rigoureux permet d’éviter un rejet partiel ou total de la liste.
Peut-on intégrer des mineurs sur une liste ?
Non. La qualité d’électeur est requise pour être candidat.
Or, un mineur ne peut pas être inscrit sur une liste électorale (sauf émancipation, mais même dans ce cas, il faut remplir toutes les autres conditions légales).
De ce fait, la présence d’un mineur sur une liste rend la candidature irrecevable pour la place concernée, ce qui peut entraîner une vacance de siège si la liste est élue.
Est-il obligatoire de présenter une liste complète ?
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le scrutin est proportionnel de liste à deux tours, avec obligation de parité et de liste complète : le nombre de candidats doit correspondre exactement au nombre de sièges à pourvoir, plus éventuellement un ou deux remplaçants selon la taille de la commune.
Une liste incomplète est irrecevable et ne pourra pas être enregistrée.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants (scrutin majoritaire plurinominal), la liste peut être incomplète : il est possible de se présenter seul ou à plusieurs sans atteindre le nombre de sièges à pourvoir.
Peut-on fusionner deux listes entre les deux tours ?
Oui, le code électoral permet la fusion de listes entre les deux tours, à condition de respecter certaines règles :
- La fusion est libre entre toutes les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour ;
- Des candidats d’une liste éliminée (ayant obtenu entre 5 % et 10 %) peuvent être intégrés sur une liste qualifiée ;
- La liste fusionnée doit rester conforme aux règles de parité et de nombre de candidats.
Cette démarche implique une déclaration de candidature modifiée, déposée avant la date limite fixée entre les deux tours
Qui décide de la fusion de liste?
Seul le « responsable de liste » peut décider des fusions de liste au second tour.
Que se passe-t-il si un colistier démissionne ?
S’agissant des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, le code électoral dispose qu’aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.
Qui choisit l’ordre des colistiers sur la liste ?
L’ordre est fixé librement par la tête de liste, sous réserve du respect de la parité : l’alternance stricte homme/femme est obligatoire dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Une fois déposée, la liste et l’ordre ne peuvent plus être modifiés sauf fusion validée.
Un colistier peut-il figurer sur plusieurs listes ?
Non, la candidature multiple est strictement interdite. Une personne inscrite sur plusieurs listes dans la même commune est inéligible sur l’ensemble des listes concernées.
Le dépôt de la liste engage donc une vérification minutieuse : chaque colistier signe une déclaration sur l’honneur confirmant qu’il ne figure sur aucune autre liste.
Un colistier peut-il être tête de liste ailleurs ?
Non. Une même personne ne peut pas être candidate dans plusieurs communes simultanément si les élections ont lieu le même jour.
Cette interdiction découle du principe de domiciliation électorale et de l’unicité de l’électeur : nul ne peut voter ni se présenter dans plusieurs communes en même temps.
Peut-on être candidat dans une commune où l’on ne réside pas ?
Oui, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de la commune ou d’y être inscrit au titre de contribuable (impôts locaux) depuis au moins deux ans.
C’est une pratique courante pour des propriétaires secondaires ou des personnes possédant une résidence secondaire.
Il faut toutefois veiller à ce que cette inscription soit régulière (pas de manœuvre frauduleuse pour s’inscrire uniquement dans le but de candidater)
Organisation de la campagne sur le terrain
Faut-il demander une autorisation pour distribuer des tracts sur la voie publique ?
En principe, la distribution de tracts électoraux sur la voie publique est libre, car elle relève de la liberté d’expression politique protégée par la Constitution.
Cependant, certaines communes imposent des règles d’occupation du domaine public : sur les marchés, devant des bâtiments publics, la mairie peut exiger une déclaration préalable ou une autorisation pour éviter les troubles à l’ordre public.
Il est donc recommandé de contacter les services municipaux pour vérifier l’existence d’un arrêté municipal spécifique.
En cas de non-respect, la distribution peut être interrompue par la police municipale.
Peut-on tenir un stand sur le marché pour faire campagne ?
Oui, à condition de respecter les règles locales d’occupation du domaine public. En général, l’installation d’un stand ou d’un barnum sur un marché nécessite une autorisation temporaire, délivrée par la mairie ou le gestionnaire du marché.
Cette autorisation peut être refusée pour des raisons de sécurité, de circulation ou de maintien de la neutralité du domaine public.
L’équipe de campagne doit veiller à ne pas gêner la circulation des commerçants et des clients. Il est conseillé de demander l’autorisation par écrit et de conserver une copie pour éviter toute contestation le jour venu.
L’utilisation d’affiches est-elle encadrée ?
Oui. La loi prévoit que l’affichage électoral est strictement réglementé afin d’assurer l’égalité entre les candidats.
Pendant la période officielle de campagne (ouverte à partir de la publication de l’arrêté préfectoral fixant la date du scrutin), l’affichage est limité aux emplacements officiels fournis par la commune.
Tout affichage sauvage (panneaux routiers, murs, abribus) est interdit et passible d’une amende.
Hors période officielle, l’affichage est toléré sous certaines conditions, mais peut être limité par un règlement local de publicité.
En cas de dégradation de panneaux officiels, le candidat doit informer la mairie ou la préfecture.
Peut-on organiser une réunion publique dans une salle communale ?
Oui, mais la commune ne peut pas discriminer entre candidats. Toute salle communale disponible pour l’organisation de réunions doit être accessible à toutes les listes, dans le respect du principe d’égalité.
Le maire peut fixer des règles d’utilisation : dépôt d’une demande écrite, paiement éventuel de frais de location, respect des horaires.
La mise à disposition doit rester neutre : il est interdit à la mairie de subventionner indirectement une campagne en offrant une salle gratuitement à une liste et pas aux autres.
Il est prudent de réserver suffisamment tôt, notamment dans les petites communes disposant de peu d’équipements.
Est-il possible d’utiliser un lieu privé pour une réunion ?
Oui. L’organisation de réunions publiques dans un lieu privé (salle louée, commerce, domicile) est libre sous réserve de respecter les règles de sécurité et d’accueil du public.
La réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) s’applique : le propriétaire doit s’assurer que le lieu est aux normes.
Le coût de la location doit être pris en charge par le mandataire financier, sans ristourne déguisée, faute de quoi cela pourrait être qualifié de don illégal.
Il est recommandé de conserver un contrat de location et une facture pour le compte de campagne.
Peut-on faire appel à une entreprise pour distribuer des tracts ?
Oui. Il est autorisé de recourir à un prestataire professionnel pour la distribution de documents électoraux (tracts, professions de foi).
Dans ce cas, le contrat de prestation doit être signé au nom du mandataire financier et payé via le compte bancaire dédié.
Toute prestation doit être facturée au prix du marché pour éviter une qualification de don en nature interdit (don d’une personne morale).
Les factures doivent être conservées intégralement pour être jointes au compte de campagne.
Un élu sortant peut-il utiliser les moyens de la mairie pour faire campagne ?
Non, l’utilisation de moyens matériels, humains ou financiers de la collectivité pour des fins électorales constitue une atteinte au principe d’égalité des candidats.
Un maire sortant peut communiquer au nom de la municipalité sur la gestion courante ou les événements institutionnels, mais ne peut pas détourner cette communication pour promouvoir sa liste.
La frontière est parfois délicate : il est interdit, par exemple, d’organiser des inaugurations à visée électorale ou de distribuer un bulletin municipal à caractère partisan durant la période de campagne.
Des irrégularités peuvent entraîner l’annulation de l’élection.
Peut-on utiliser un véhicule avec publicité pour la campagne ?
Non. L’affichage électoral sur des véhicules est illégal, a jugé le Conseil d’État.
La distribution de gadgets ou objets promotionnels est-elle autorisée ?
L’achat d’objets promotionnels distribués gratuitement au cours de la campagne électorale, destinés à la promotion du candidat, constitue une dépense effectuée en vue de l’élection. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la distribution de ces objets, faite indépendamment de la qualité d’électeur de leurs destinataires, ne revêt pas le caractère illicite d’un don effectué en vue d’influencer le sens du vote des électeurs au sens de l’article L. 106 du Code électoral cette dépense est susceptible d’ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat.
Peut-on organiser une opération de porte-à-porte ?
Oui, la démarche de porte-à-porte est parfaitement licite et constitue un mode traditionnel de campagne.
Il convient de respecter le droit au respect de la vie privée : les équipes doivent rester courtoises et ne pas insister en cas de refus.
Il est recommandé de former les bénévoles pour éviter tout comportement intrusif.
Les éventuels frais (impression de flyers distribués) doivent être réglés par le mandataire financier.
Communication et propagande électorale
Quelles sont les règles encadrant l’utilisation des réseaux sociaux pour la campagne ?
L’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok…) est autorisée pendant une campagne électorale.
Cependant, il convient de respecter certaines obligations :
- Les publications relèvent de la propagande électorale et il ne peut y avoir de publicité
- Les contenus ne doivent pas diffuser de fausses informations ni porter atteinte à la vie privée des opposants.
- Les commentaires ou modérations doivent être suivis avec soin pour éviter des propos diffamatoires sur les pages officielles du candidat.
Une bonne pratique consiste à archiver les publications (captures d’écran, liens) pour justifier leur coût dans le compte de campagne.
Peut-on diffuser une vidéo de campagne sur YouTube ?
Oui, la diffusion de contenus vidéo est autorisée.
La vidéo doit toutefois respecter le droit à l’image et ne pas contenir d’éléments calomnieux ou diffamatoires.
Si la vidéo est produite par un prestataire extérieur, le coût doit être pris en charge par le mandataire financier et justifié par une facture.
En outre, il faut veiller à respecter les règles de silence électoral : la vidéo doit être mise en ligne au plus tard la veille du scrutin, sans sponsoring après zéro heure.
Enfin, il est conseillé d’intégrer une mention légale (nom du mandataire financier) sur la vidéo.
Peut-on utiliser l’adresse mail d’administrés pour envoyer une newsletter de campagne ?
Non. Il est interdit d’utiliser des fichiers ou bases de données constitués à d’autres fins (ex. : fichier des administrés, liste d’abonnés à une newsletter municipale).
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose d’obtenir le consentement explicite des personnes pour recevoir une communication électorale.
Toute utilisation de fichiers municipaux est sanctionnée car elle viole le principe d’égalité entre candidats.
Les adresses mail collectées par le candidat doivent l’être via un formulaire dédié et l’inscription doit être volontaire et vérifiable.
Peut-on utiliser une page Facebook de la mairie pour relayer la campagne ?
Non. La page officielle de la mairie doit demeurer neutre et ne relayer aucune information de campagne électorale.
Toute utilisation d’un support institutionnel pour promouvoir une liste constitue un usage irrégulier de moyens publics, contraire à l’article L. 52-1 du code électoral.
Le maire sortant peut continuer à gérer les affaires courantes et communiquer sur la vie de la commune, mais sans contenu à caractère partisan.
Les publications ambiguës ou partisanes peuvent conduire à une annulation de l’élection.
Un candidat peut-il donner une interview à la presse locale pendant la campagne ?
Oui, cela fait partie de la liberté d’expression et du pluralisme.
Toutefois, la presse doit traiter l’ensemble des candidats de manière équitable : le directeur de publication engage sa responsabilité s’il accorde un traitement manifestement déséquilibré.
Le candidat doit veiller à ne pas utiliser l’interview pour annoncer des promesses ou des engagements contraires à la législation, notamment en matière de dons ou d’avantages individuels.
L’entretien doit être archivé, car il constitue un élément de la campagne et peut être versé au compte de campagne pour estimer le coût d’éventuels encarts payants.
Quels documents officiels peut-on diffuser durant la campagne ?
Les seuls documents électoraux autorisés sont :
- Les bulletins de vote ;
- La profession de foi (ou circulaire) ;
- Les affiches officielles apposées sur les panneaux réservés à cet effet.
Tout document doit mentionner le nom et l’adresse de l’imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral).
La diffusion de tracts supplémentaires est libre, mais ils doivent également comporter ces mentions obligatoires.
Peut-on publier un sondage pendant la campagne ?
Oui, mais sous conditions. Un sondage doit être réalisé par un institut agréé et respecter la loi sur la transparence des sondages électoraux.
Il doit être déclaré à la Commission des sondages, indiquer la méthodologie, l’échantillon et la marge d’erreur.
La publication de tout nouveau sondage est interdite la veille et le jour du scrutin.
Un sondage non déclaré ou diffusé hors délai peut invalider le scrutin.
Que risque-t-on en cas de non-respect du silence électoral ?
Le silence électoral commence la veille du scrutin à zéro heure et interdit toute diffusion de propagande (tracts, messages sur les réseaux sociaux, encarts publicitaires).
Le non-respect est puni pénalement et peut être sanctionné par le juge électoral notamment si cela a pu altérer la sincérité du scrutin.
Des publications laissées en ligne sans sponsoring sont tolérées, mais tout nouveau contenu ou toute relance payante est prohibée.
Le candidat est responsable du respect de cette règle par l’ensemble de son équipe.
Quid des posts sponsorisés?
De nombreux candidats pensent qu’ils peuvent « booster » leurs publications Facebook, Instagram, TikTok, X ou LinkedIn comme n’importe quel contenu commercial.
L’article L. 52-1 du Code électoral interdit toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale.
Or, un « boost » Facebook ou une publicité sponsorisée Instagram est juridiquement considéré comme une prestation publicitaire payante.
Elle est donc assimilée à une publicité commerciale interdite, sauf s’il s’agit de frais de fonctionnement du site ou de la page eux-mêmes (hébergement, community manager…).
Financement de la campagne
Le mandataire financier est-il obligatoire pour une liste municipale ?
Oui, pour les communes de 9 000 habitants et plus, la désignation d’un mandataire financier est obligatoire dès lors que le candidat ouvre un compte de campagne ou engage des dépenses (art. L. 52-4 du code électoral).
Le mandataire peut être soit une personne physique, soit une association de financement électoral déclarée en préfecture.
Sans mandataire désigné, aucune dépense ne peut être réglée ni aucun don perçu légalement.
Pour les communes de moins de 9 000 habitants, le mandataire n’est pas obligatoire, mais toute dépense électorale doit malgré tout être justifiée en cas de contrôle.
Qui peut être désigné comme mandataire financier ?
Toute personne physique majeure et juridiquement capable peut être désignée.
Il est préférable de choisir une personne de confiance, rigoureuse, disponible et sans lien d’intérêt susceptible de créer un conflit (par exemple : un proche employé municipal peut soulever une difficulté).
Si une association de financement est choisie, elle doit être déclarée en préfecture et disposer de statuts conformes à la loi.
La désignation doit être notifiée à la préfecture au plus tôt afin d’ouvrir le compte bancaire dédié.
Comment ouvrir un compte de campagne ?
Le compte doit être ouvert au nom du mandataire (ou de l’association) auprès d’un établissement bancaire.
Ce compte unique est obligatoire pour centraliser toutes les recettes (dons, subventions, prêts) et toutes les dépenses (impression, location de salle, publicité).
Il est interdit de payer des dépenses en espèces au-delà d’un certain seuil ou via le compte personnel du candidat.
La banque peut exiger l’attestation de désignation délivrée par la préfecture.
Quels types de dons sont autorisés ?
Seuls les dons de personnes physiques sont autorisés, dans la limite de 4 600 euros par donateur et par élection (art. L. 52-8 du code électoral).
Les dons de personnes morales (entreprises, associations, syndicats, personnes publiques) sont strictement interdits.
Les dons anonymes sont interdits sauf les dons en numéraire inférieurs à 150 €, mais même pour ceux-ci, un reçu doit être établi.
Tout don doit transiter par le compte du mandataire financier. En cas de contrôle, le candidat doit être en mesure de prouver l’origine des fonds.
Peut-on financer sa campagne par un prêt bancaire ?
Oui. Le candidat ou le mandataire financier peut contracter un prêt bancaire pour couvrir les dépenses électorales, à condition que le prêt soit souscrit auprès d’un établissement bancaire dûment habilité. Les personnes physiques peuvent également consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
Les conditions doivent être transparentes et respecter le droit commun du crédit.
Le remboursement du prêt doit être justifié dans le compte de campagne.
Il est interdit de recourir à un prêt déguisé émanant d’une personne morale non autorisée.
Qui contrôle le compte de campagne ?
Après l’élection, le compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l’élection est acquise.
La CNCCFP vérifie la régularité des recettes et des dépenses, le respect des plafonds légaux et la cohérence des pièces justificatives.
En cas de manquement grave (dépenses non justifiées, dépassement du plafond), le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat.
Quelles dépenses doivent figurer dans le compte de campagne ?
Toutes les dépenses engagées dans le but d’obtenir les suffrages des électeurs, entre le 1er jour de l’année de l’élection et la date du scrutin, doivent être inscrites.
Cela comprend notamment : affiches, tracts, bulletins de vote, professions de foi, location de salles, prestations de conseil, sites internet, frais postaux, frais de déplacement, flocage de véhicules, hébergement de meetings.
Les dépenses doivent être justifiées par des factures datées et réglées via le compte du mandataire.
Existe-t-il un plafond de dépenses pour les élections municipales ?
Oui, le plafond est fixé par décret et dépend du nombre d’habitants de la commune.
À titre indicatif : pour les communes de plus de 9 000 habitants, le plafond était de 1,22 € par habitant, auquel s’ajoutent 0,05 € par habitant pour les communes chefs-lieux de département et 0,15 € pour les chefs-lieux de région.
Ces montants peuvent évoluer chaque année.
Le non-respect du plafond est passible d’inéligibilité.
Que se passe-t-il si des dépenses sont réglées hors compte de campagne ?
Toute dépense électorale doit impérativement transiter par le compte du mandataire financier.
Un paiement effectué en espèces ou par un tiers sans traçabilité constitue une infraction.
En cas de contrôle, ces dépenses non retracées peuvent être réintégrées au compte de campagne, voire entraîner un rejet du compte par la CNCCFP et une sanction par le juge électoral.
Le candidat peut-il se rembourser des frais ?
Oui, le candidat peut avancer des frais à titre personnel pour la campagne (ex. : impression urgente, frais de déplacement).
Cependant, ces frais doivent être remboursés par le mandataire financier via le compte de campagne pour rester traçables.
Le remboursement doit figurer dans le compte final et être justifié par des factures précises.
Il est déconseillé de multiplier les avances personnelles : le mieux est que le mandataire règle directement toutes les dépenses
Organisation du scrutin et déroulement du vote
Qui désigne les assesseurs dans un bureau de vote ?
Les assesseurs sont désignés par chaque candidat ou liste de candidats, parmi les électeurs inscrits dans la commune.
Chaque liste peut nommer un assesseur titulaire et éventuellement un suppléant par bureau de vote (art. R. 44 et R. 45 du code électoral).
Le président du bureau de vote est généralement le maire ou un adjoint, ou à défaut un conseiller municipal.
Si un candidat ne désigne pas d’assesseur, le président du bureau pourvoit aux vacances parmi les électeurs présents.
Quelles sont les missions des assesseurs ?
Les assesseurs participent au bon déroulement des opérations de vote :
- Ils contrôlent l’identité des électeurs,
- Vérifient leur inscription sur la liste d’émargement,
- Veillent à la régularité du vote,
- Signent les procès-verbaux.
Ils ont également un rôle de surveillance et peuvent signaler toute irrégularité.
Ils doivent être présents pendant toute la durée du scrutin et peuvent participer au dépouillement.
Qu’est-ce qu’un délégué de liste ?
Le délégué de liste est une personne désignée par chaque liste pour surveiller le déroulement du scrutin dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Il est distinct de l’assesseur.
Le délégué peut circuler librement dans le bureau, observer les opérations de vote, vérifier l’urne et assister au dépouillement.
Il a le droit de formuler des observations inscrites au procès-verbal.
Sa désignation doit être notifiée au président du bureau de vote avant l’ouverture du scrutin.
Peut-on remplacer un assesseur en cours de journée ?
Oui. Un assesseur peut être remplacé par son suppléant ou un autre électeur de la commune désigné par la liste concernée.
Il est essentiel d’assurer une continuité pour garantir la régularité du scrutin.
Le remplacement doit être mentionné sur le procès-verbal.
L’absence prolongée d’un assesseur peut être signalée, mais elle n’entraîne pas l’annulation du scrutin si les autres membres du bureau sont présents.
Un électeur peut-il voter sans pièce d’identité ?
Dans une commune de 1 000 habitants et plus, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (art. R. 60 du code électoral).
La liste des pièces acceptées est fixée par arrêté (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo…).
Sans pièce, le président du bureau doit refuser le vote, même si l’électeur est connu.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une tolérance existe, mais il reste préférable d’exiger une pièce d’identité pour éviter toute contestation.
Quelles règles s’appliquent aux procurations ?
Un électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même commune, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
Depuis 2022, un mandataire peut recevoir deux procurations maximum, dont une seule établie en France.
La procuration doit être enregistrée par l’autorité compétente (commissariat, gendarmerie, tribunal) ou via le téléservice Maprocuration.gouv.fr.
Le mandataire doit présenter sa propre pièce d’identité le jour du vote ; le président vérifie que la procuration est valide.
Peut-on contester une procuration le jour du vote ?
En principe, une procuration régulièrement établie ne peut pas être contestée au bureau de vote.
Toutefois, si un doute sérieux existe sur l’authenticité ou si un usage frauduleux est constaté (usurpation, procuration falsifiée), le président peut refuser de la prendre en compte et en faire mention au procès-verbal.
Une contestation ultérieure relève du juge de l’élection qui peut être saisi en cas de fraude avérée.
Que faire en cas d’incident dans un bureau de vote ?
Tout incident (trouble à l’ordre public, tentative de fraude, refus d’accès aux délégués ou journalistes, irrégularité manifeste) doit être signalé au président du bureau de vote.
Le président peut faire appel aux forces de l’ordre si nécessaire pour garantir la sécurité.
Les faits doivent être consignés au procès-verbal et signés par les membres du bureau.
En cas d’irrégularité grave susceptible d’affecter la sincérité du scrutin, un recours peut être formé devant le tribunal administratif. L’altération de la sincérité est défini en fonction de l’écart de voix et des conséquences prévisibles du manquement.
Comment se déroule le dépouillement ?
Le dépouillement commence immédiatement après la clôture du scrutin (généralement à 18h ou 20h selon l’arrêté préfectoral).
Il doit être public : tout électeur peut assister au dépouillement.
Les bulletins sont regroupés par tables de dépouillement où siègent quatre scrutateurs, assistés des membres du bureau.
Chaque enveloppe est ouverte, les bulletins sont comptés et le résultat est reporté sur des feuilles de dépouillement.
Les résultats sont en suite centralisés et inscrits au procès-verbal signé par le président, les assesseurs et les délégués de liste.
Peut-on demander un recomptage des bulletins ?
Oui. Toute personne habilitée (assesseur, délégué de liste, candidat) peut demander un recomptage s’il existe un doute sur le décompte des bulletins ou des enveloppes.
Le président du bureau doit accéder à cette demande, sauf abus manifeste ou manœuvre dilatoire.
Le recomptage doit être effectué dans le respect des règles de publicité et de transparence.
Les observations ou contestations doivent être consignées dans le procès-verbal pour être recevables devant le juge électoral.
Litiges électoraux et contentieux après scrutin
Qui proclame les résultats des élections municipales ?
La proclamation provisoire des résultats est faite par le président du bureau de vote immédiatement après le dépouillement.
Pour les communes à bureau unique, cette proclamation vaut pour toute la commune.
Dans les communes comportant plusieurs bureaux, les résultats sont centralisés par la commission de recensement des votes présidée par le maire ou son représentant.
La proclamation officielle et définitive intervient après validation par le préfet et expiration du délai de recours contentieux, sauf si un juge est saisi.
Peut-on contester la validité du scrutin ?
Oui. Tout électeur inscrit dans la commune, tout candidat ou le préfet peut saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation.
Ce recours doit être formé dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats (art. L. 248 du code électoral).
Passé ce délai, le recours est irrecevable.
La décision du juge administratif peut confirmer, invalider ou modifier les résultats.
Quelles irrégularités peuvent conduire à l’annulation d’une élection municipale ?
Le juge apprécie si les irrégularités invoquées ont altéré la sincérité du scrutin.
Sont notamment susceptibles de justifier une annulation :
- Fraudes avérées (bourrage d’urnes, fausses procurations),
- Propagande irrégulière le jour du vote (tracts de dernière minute),
- Dépassement du plafond des dépenses,
- Comptes de campagne irréguliers,
- Dysfonctionnements graves dans l’organisation du scrutin (bulletins manquants, absence de contrôle d’identité).
Cependant, une irrégularité mineure sans influence sur le résultat est sans effet.
Qui juge les recours ?
Le juge compétent est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la commune.
Il statue en premier et dernier ressort pour les communes de moins de 9 000 habitants.
Pour les communes plus importantes, un appel est possible devant le Conseil d’État, qui statue définitivement.
Le juge dispose de pouvoirs étendus : annuler l’élection, proclamer un autre candidat élu, déclarer l’inéligibilité, ou rejeter le recours.
Quelles sont les conséquences d’une annulation ?
En cas d’annulation, une nouvelle élection municipale doit être organisée dans un délai de 3 mois.
Le préfet convoque alors les électeurs.
Le maire et le conseil municipal sortants restent en fonction pour gérer les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouveau conseil.
L’annulation peut aussi être assortie de sanctions personnelles (inéligibilité du candidat fautif).
Qu’est-ce qu’une inéligibilité en matière électorale ?
L’inéligibilité est la sanction qui prive une personne du droit de se présenter à une élection pour une durée déterminée (souvent un an, parfois plus selon la gravité des faits).
Elle peut être prononcée par le juge administratif ou, pour des infractions pénales (fraude, corruption électorale), par le juge judiciaire.
Un manquement grave aux règles de financement, un dépassement du plafond ou un compte de campagne rejeté peut entraîner l’inéligibilité du candidat et, le cas échéant, la perte du mandat.
Qui peut signaler une fraude électorale ?
Tout électeur, candidat, assesseur ou délégué de liste peut signaler une fraude aux autorités compétentes : président du bureau de vote, forces de l’ordre, préfet, ou directement au procureur de la République.
Un signalement doit être appuyé de faits précis et, idéalement, d’éléments matériels (témoignages, photos, procès-verbal).
Ces éléments seront utiles pour fonder un recours contentieux ou une plainte pénale.
Existe-t-il une sanction pénale pour fraude électorale ?
Oui. Le code électoral prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement pour de nombreuses infractions :
- Fraude dans l’établissement des procurations,
- Bourrage d’urnes,
- Falsification de bulletins ou de procès-verbaux,
- Pressions ou violences pour influencer un vote.
Ces infractions relèvent du juge pénal et sont poursuivies par le procureur de la République.
Quels sont les délais pour statuer sur un contentieux électoral ?
Le tribunal administratif doit statuer rapidement. En général, le juge statue dans un délai d’environ 3 mois.
En cas d’appel devant le Conseil d’État, le délai peut être prolongé de quelques semaines à quelques mois supplémentaires.
Pendant ce temps, le conseil municipal reste en place sauf décision de suspension ou d’annulation immédiate.
Le candidat peut-il continuer à siéger en cas de recours ?
Oui. Tant que l’élection n’est pas annulée de manière définitive, le maire ou le conseiller municipal proclamé élu exerce pleinement ses fonctions.
En cas d’annulation, le mandat est retiré rétroactivement à la date de la décision.
Si une inéligibilité est prononcée, elle s’applique immédiatement et entraîne la perte du mandat.
Peut-on modifier la liste entre les deux tours ?
Oui, mais sous certaines conditions strictes.
Une liste peut être modifiée uniquement par fusion avec une autre liste.
Il est interdit de retirer ou d’ajouter des candidats individuellement sans fusion.
Les modifications doivent respecter la parité homme/femme et être déposées officiellement auprès du maire ou préfet avant la date limite.
Une fois déposée, la liste modifiée devient la liste officielle pour le second tour.
Quelles sont les conditions d’éligibilité pour devenir maire ?
Le maire doit être membre du conseil municipal et remplir les conditions générales d’éligibilité (être inscrit sur la liste électorale de la commune, avoir la nationalité française ou européenne, ne pas être privé de ses droits civiques).
Il doit également être âgé de 18 ans au moins.
La loi ne prévoit pas de conditions spécifiques supplémentaires, mais des incompatibilités peuvent s’appliquer selon d’autres fonctions occupées.
L’élection du maire se fait par le conseil municipal au scrutin secret, à la majorité absolue des membres.
Comment se déroule l’élection du maire en conseil municipal ?
L’élection du maire intervient lors de la première réunion du conseil municipal suivant l’élection des conseillers.
Le scrutin est secret et se déroule à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et second tour.
Si aucun candidat n’obtient la majorité, un troisième tour est organisé où la majorité relative suffit.
En cas d’égalité parfaite au troisième tour, le plus âgé est élu.
L’élection est immédiatement annoncée et doit être inscrite au procès-verbal.
Quelle est la durée du mandat du maire et des conseillers municipaux ?
Le mandat est de six ans, renouvelable sans limitation de nombre de mandats consécutifs.
Les élections municipales ont lieu tous les six ans, sauf cas exceptionnel (dissolution, annulation).
Le mandat cesse également en cas de démission, décès, ou inéligibilité prononcée.
Le maire et les conseillers restent en fonction jusqu’à l’installation effective de leurs successeurs.
Nausica Avocats est un cabinet d’avocats intervenant en droit électoral. N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problématiques dans le cadre des élections municipales.
